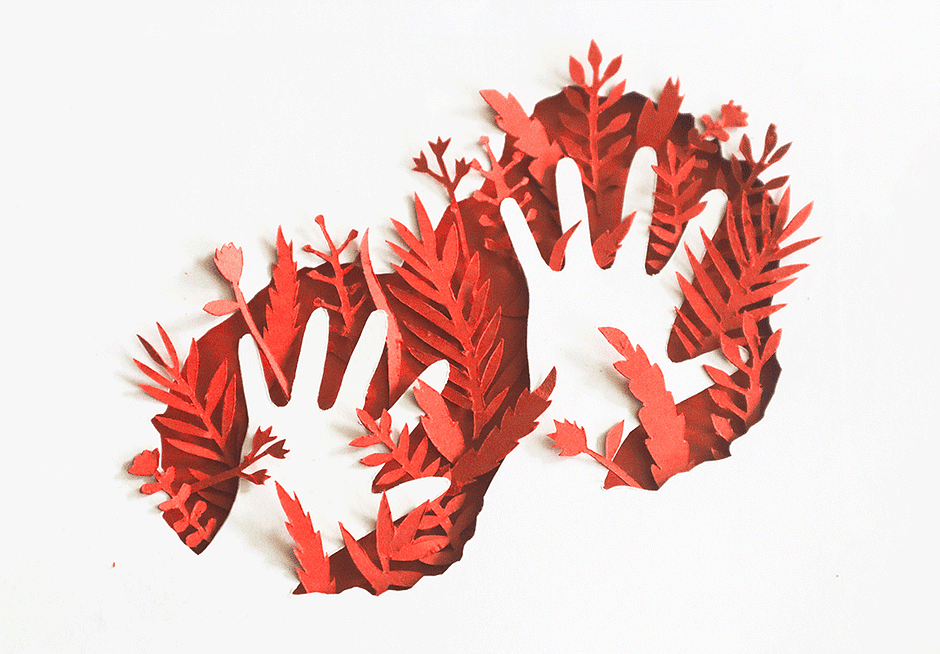Le suicide des Guarani - Comment la séparation entre l'homme et la nature peut affecter le psychisme

‘De nombreux enfants souffrent’ nous dit Dilma Modesto, une agente de santé guarani du Brésil. Je veux que les enfants redeviennent comme ils étaient avant, lorsque tout allait bien’.
‘Avant’ c’était lorsque les Guarani chassaient librement sur leurs terres et plantaient du manioc et du mais dans leurs jardins. C’était avant qu’on leur vole leur forêt et qu’on la transforme en vastes étendues d’élevage bovin, en champs de soja et en plantations de canne à sucre. ‘Avant’, c’était lorsqu’ils éprouvaient encore de la fierté et qu’ils avaient le contrôle de leur vie, avant qu’ils ne soient réduits à vivre sous des lambeaux de toiles en plastique, le long de routes poussiéreuses et forcés à boire de l’eau polluée dans des bidons en plastique.
En fait lorsque tout allait bien, c’était bien avant que les enfants guarani ne commencent à se suicider. Ces trente dernières années, plus de 625 Indiens Guarani se sont donnés la mort. ce qui rend leur taux de suicide 19 fois plus élevé que la moyenne nationale du Brésil. Les jeunes adultes de moins de 30 ans représentant 85% de ces suicides. Et pire encore, le plus jeune n’avait que 9 ans.
La perte et la destruction de leurs terres sont à la racine de cet état de souffrance effroyable. Car pour les Guarani – comme d’ailleurs pour la plupart des peuples autochtones – la terre est tout. Elle est celle qui les nourrit et les abrite, qui façonne leurs langages, leurs idées sur le monde et leur identité. C’est également le lieu de sépulture de leurs ancêtres et l’héritage de leurs enfants. La terre, c’est tout simplement ce qu’ils sont. La frontière entre le monde naturel qui les entoure et leur monde intérieur est en fait bien mince.
Jadis, la terre des Guarani s’étendait sur une superficie de quelques 350 000 km2 de forêts et de plaines. Ils sont aujourd’hui entassés sur de minuscules parcelles de terre. ‘Les Guarani se suicident parce qu’ils n’ont plus de terre’ déplore une femme guarani, ‘Avant, nous étions libres. Maintenant nous ne le sommes plus. Alors nos jeunes gens regardent autour d’eux, se rendent compte que nous n’avons plus rien, s’assoient, se mettent à penser, se perdent et finalement se suicident’.
Ces dernières années, on a beaucoup écrit à propos des effets dévastateurs de cette séparation du monde naturel sur le psychisme humain. Le regretté philosophe Paul Sheppard, brillant pionnier de l’écologie et auteur de Nature and Madness (Nature et folie), était convaincu que la destruction écologique a eu des répercussions très profondes sur notre stabilité mentale en tant qu’espèce. Dans son livre Last Child in the Woods (Le dernier enfant dans les bois), le journaliste Richard Louv n’a pas hésité à parler de ‘troubles dus au manque de nature’ à propos d’enfants ayant été privés de contact avec la nature.
 © João Ripper/Survival
© João Ripper/Survival
Les peuples autochtones sont sans doute les mieux placés pour comprendre les effets négatifs de cette séparation d’avec le monde naturel. En règle générale, l’identité d’un peuple autochtone s’est construite au fil des générations dans une relation symbiotique avec son environnement immédiat. Quand ils sont contraints de quitter leurs terres, le changement est souvent bien trop soudain pour que l’esprit puisse s’adapter à la nouvelle situation et la supporter. ‘Quand vous êtes si proche de la nature, que vous êtes entouré de forêts, vous avez la vie, vous avez tout’, dit un Guarani. La réinstallation forcée signifie que ‘tout’ devient ‘rien’ – une perspective que de nombreux peuples autochtones ont subi, et à laquelle bien d’autres sont encore confrontés – et souvent s’ensuivent la dévastation mentale et spirituelle. ‘Alors, vous devenez spirituellement vide’, a t-il poursuivi.
Au Canada, le taux de suicide chez les Innu est tout aussi élevé. Il y a seulement 50 ans, les Innu étaient encore nomades. Ils pratiquaient la migration saisonnière à travers les forêts de saules et d’épinettes du Nitassinan, leur territoire ancestral subarctique, y chassaient le caribou, l’orignal et du petit gibier. Cette terre nordique de forêts labyrinthes et de rivières sinueuses était la leur depuis 7500 ans, elle a forgé leur histoire, leurs compétences, leur cosmologie et leur langue et renforcé leur singularité en tant que société humaine. ‘La terre fait partie de notre vie’, dit George Rich, un Innu. ‘Tout ce qui est relié à la terre symbolise l’identité innu – qui vous êtes en tant qu’être humain.’
Au cours des années 1950 et 1960, le gouvernement canadien et l’Église catholique, persuadés qu’ils savaient mieux que les Innu la façon dont ils devaient vivre, les forcèrent à se sédentariser et à s’établir dans des communautés fixes. Ainsi, brimés dans leur existence même en tant que pâles répliques d’un monde européen qu’ils ne comprenaient pas et ne voulaient pas (le gouvernement canadien disait qu’il voulait qu’ils deviennent ‘comme tous les autres Canadiens’), plongés dans un no-man’s land de confusion culturelle et de désespoir existentiel, les Innu devinrent vite dépressifs. L’inhalation d’essence devint une habitude courante chez les enfants. Les chasseurs, privés de mouvement, de liberté, de sens et de but, se dévalorisèrent et devinrent alcooliques. Autrefois, lorsque les services sociaux demandaient à un Innu quelle était son occupation, il répondait : ‘chasseur’. Maintenant, il dit : ‘chômeur’, déplore Jean-Pierre Ashini, un Innu.
La dépression a été exacerbée par le changement radical d’une alimentation naturelle riche en huiles naturelles de poisson à une autre chargée de sucre ainsi que par la diminution d’exercice physique. ‘Le passage soudain du régime alimentaire de gibier, poisson et cueillette à celui de la nourriture occidentale achetée au supermarché est un facteur de risque important lié à la détérioration de la santé mentale des peuples circumpolaires, a déclaré l’anthropologue Colin Samson, qui a travaillé avec les Innu pendant plusieurs décennies.
La disparition d’un mode de vie bien établi a aggravé les problèmes liés à la santé – ce qui est souvent le cas de la plupart des groupes qui ont été déplacés – et sapé les bases d’un bon équilibre mental. L’estime de soi, le sentiment que sa vie a un but et un sens, le besoin d’espoir et d’être considéré avec bienveillance par les autres, tout ceci a disparu, emporté par le violent mépris des autorités vis-à-vis de ces modes de vie traditionnels. Le psychologue américain Abraham Maslow était convaincu que les êtres humains ont une ‘hiérarchie de besoins’ sans laquelle ils ne peuvent fonctionner normalement. La nourriture, l’air et l’eau sont incontestablement essentiels à toute vie. Mais la sécurité, l’estime de soi, le respect, l’amour et l’appartenance ne sont pas loin derrière ces besoins physiologiques fondamentaux et sont essentiels à l’épanouissement de tout être humain. Aussi, lorsque le mode de vie des Innu fut jugé ‘arriéré’ par les autorités, lorsque leurs croyances religieuses furent ridiculisées et assimilées à un culte du diable par l’Eglise, lorsque leurs idées et leurs opinions furent rejetées parce que sans valeur, ils finirent par y croire. L’esprit innu, déjà mis à mal s’en trouva encore plus affaibli. ‘Si on vous dit que votre mode de vie ne vaut rien, que pouvez-vous faire ?’ demande un Innu.
Malheureusement, les Guarani et les Innu ne sont pas les seuls dans ce cas. Durant des siècles, la santé mentale de nombreux groupes autochtones a été annihilée par des envahisseurs qui ne pouvaient pas supporter (ou ne voulaient pas, car le racisme et le déni culturel ont été des outils utiles depuis l’époque coloniale pour s’emparer des terres et des ressources) que ‘les gens qui vivent d’une manière distincte, choisissent encore des voies différentes pour progresser sur le chemin de la vie’ comme l’expliquait le chef ponca Standing Bear.
Dans son livre Tribal Peoples for Tomorrow’s World (Les peuples autochtones dans le monde de demain), le directeur de Survival, Stephen Corry, fait valoir que si les peuples autochtones ont fait des choix qui diffèrent de la plupart de ceux des sociétés industrialisées ‘préférant être mobiles plutôt que sédentaires, chasseurs ou bergers plutôt qu’agriculteurs, n’ambitionnant nullement de ’s’améliorer’ par l’accumulation de richesses, ils ne sont pas plus arriérés que n’importe qui d’autre’. Ce n’est pas seulement de la vanité de la part d’une société de se croire plus avancée ou ‘civilisée’ qu’une autre – grâce à ses richesses matérielles ou à ses progrès technologiques – c’est une illusion. ‘Vous avez votre voie, a dit Nietzsche… et j’ai la mienne. Quant à la bonne voie, la voie correcte et la voie unique, elle n’existe pas’.
Pour les peuples autochtones, il ne peut y avoir de santé mentale stable sans la terre ou la possibilité de maîtriser son propre avenir. Ainsi, la réponse à leur désespoir se trouve dans des solutions relativement simples : la terre et l’autodétermination. Les statistiques montrent que lorsque ces peuples vivent d’une façon autonome sur leurs propres terres, ils sont en bien meilleure santé que ceux qui ont été déracinés et à qui on a imposé le ‘progrès’. ’S’ils peuvent jouir pleinement de leurs terres, la plupart des peuples autochtones ne sont pas particulièrement fragiles’ écrit Stephen Corry. ‘Ils sont aussi capables de survivre et de s’adapter à de nouvelles circonstances que n’importe lequel d’entre nous.’
Le film La terre des hommes rouges – Birdwatchers dépeint d’une façon très émouvante le processus de dépossession territoriale des Guarani. Lorsque leur chef est pris à partie par un colon agressif de troisième génération qui revendique ses terres ancestrales, il se penche, ramasse une poignée de terre rouge et commence à la manger. En un seul geste simple, il démontre ainsi que sa terre et son groupe sont indissociables.
‘Nous, les Indiens, nous sommes comme les plantes, disait Marta Guarani. ‘Comment pouvons-nous vivre sans notre terre, sans notre sol ?